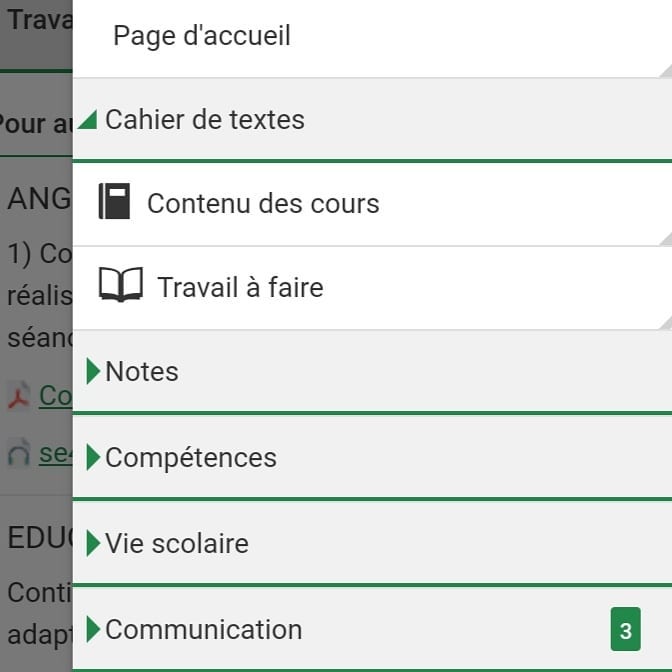Jour 38. Confinement 2020.
Nous faisons, tous en ce moment, une expérience bien désagréable : la contrainte.
On nous a fermé les bars, les églises, interdit les fêtes de mariage, fermé les restaurants pour les midis entre collègues, punis de collègues à la machine à café, interdit les réunions où on arrivait des fois à faire passer ses propres idées, interdit les essayages vite fait de cette jolie paire de chaussures. On nous a même interdit de déjeuners de famille où on mange trop et où on se râle dessus les uns les autres. Interdit de bises, interdit de baisers.
Alors on ne se maquille plus. On ne se rase plus. On ne s’apprête plus. On ne se parfume plus. On n’achète plus rien d’autre que ce qu’on va consommer, rien que le nécessaire. Le strict minimum, et rien d’autre.
Au début, nous fûmes plein d’envies, plein d’allant. Nous devenons moroses et lents.

Nous expérimentons, tous, la contrainte. Et la crainte.
La peur de sortir, la peur de l’autre, la peur de mal faire dehors et que l’autre nous juge comme mauvais, comme dangereux, comme sale. Quel est le bon geste ? Le masque, lequel dois-je prendre ? La peur d’être mis au ban. La peur de voir nos enfants s’enfoncer dans ce ban sans la meilleure éducation possible. La peur de voir leurs cerveaux rétrécir à force de vidéos sur Youtube dont nous ne maîtrisons pas tout. La peur d’être de mauvais parents parce que notre morosité nous a fait baisser les bras aujourd’hui, et puis hier, espérons que demain ça ira mieux. La peur de mourir si on échoue, mourir un tube dans la gorge pendant des jours, absent. La peur de n’être pas assez solides pour supporter tout ça, toutes nos peurs. L’envie de se noyer dans des séries télé parce que leur réalité est agréable, dorlotante, divertissante de notre morosité. L’envie de s’évader alors courir et voler, et se cogner la tête à la fenêtre fermée de l’extérieur, toujours. Interdit, tout est interdit. Sortir est dérogatoire. Aimer est contraint. Nous sommes tous l’Autre potentiellement contagieux. Nos corps sont devenus l’ennemi public numéro 1.
Ce que nous expérimentons dans nos corps aujourd’hui, cette tristesse calme de ne pouvoir voir nos amis, de ne pouvoir être ce qui nous plaît, cet estomac noué, ce cerveau ralenti… cette contrainte imposée, détestable, c’est le état de corps que les pauvres ressentent de janvier à décembre, tout le temps, tous les ans, avec en plus la culpabilité de ne pouvoir nourrir correctement leurs familles. Oh oui, on s’y habitue. On trouve des trucs. On abdique sur l’espoir de ravoir un jour une vie normale, comme celle dans les séries. On s’abonne à Netflix. On abdique sur notre dignité, aussi. On fabrique des masques, pas en tissus. On fait semblant.

On trouve des « trucs », pour paraître vivants, mais on ne sait plus où est la Vie. Moi je préparais des goûters. C’est beau, les goûters. C’était la fête tous les quatre heures à la maison quand les enfants étaient petits et que seul le RSA nous nourrissait. Des gâteaux maison avec du glaçage dessus, de la jolie vaisselle (cadeaux, récup, Emmaüs, pas cher mais joli) pour faire semblant d’être vivants et heureux. Et créer de la joie, pour que la Joie nous porte. Alors à force de se forcer à sourire on finit par sourire vraiment. J’aurais pu aussi parler de couchers de soleil, de parcs, de toutes ces jolies choses où on s’extasie gratuitement ou presque. Mais cette Joie nous porte dedans, pas dehors. Dehors c’est la peur de sortir non maquillée juste parce qu’en fait, on n’a plus de démaquillant, ou plus de ricil, et que ça coûte au moins 10 balles, un ricil. Dehors, c’est croiser les anciens amis qui disent « tu viens vendredi soir ? on va à ce concert », et puis qui ne vous le disent même plus, tellement ils ont oublié que vous saviez sortir, avant. Faire semblant d’être debout quand tout son être est liquéfié par la peur de sortir de la contrainte imposée par le pouvoir de l’argent : le pouvoir d’achat, ce dieu tout puissant pouvoir qui s’achète avec l’argent que les autres ont, qu’on n’a pas. La contrainte du pauvre, c’est ça, c’est ce qu’on a, là.
Nous sommes tous pauvres de liberté, en ce moment.
Et ceux qui étaient pauvres avant, sont tombés aussi, le même jour que nous. Tombés dans l’hyper pauvreté. Avant ils ne pouvaient pas aller au restau. Aujourd’hui ils ne peuvent plus aller au LIDL.
Si nous pouvions tous, à ce moment où on se dit « ah ben non, en fait je ne peux pas » nous prenions une minute pour ressentir ce que ça nous fait en dedans. Ce sera la graine pour que demain nous soyons tous plus à l’écoute, non dans la charité ni la pitié mais dans l’empathie. Et si nous sommes capables de cette empathie avec l’empêché, le contraint alors elle pourra nous permette de construire une société plus sûre pour tous avec comme seule question, venant du plus profond de nos êtres, de notre expérience contrainte : « Comment faire pour que l’insupportable ne se reproduise plus jamais ? Pour personne ? ».